Un article d’Héritage Montréal par Maude Bouchard Dupont, en collaboration avec Dinu Bumbaru, directeur des politiques et Marie-Maxime de Andrade, doctorante en histoire de l’art (UQAM et Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
L’art déco entre traditions et modernité
L’appellation « Art déco » tire son nom de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, tenue à Paris en 1925. C’est à ce moment que cette esthétique, née dès les années 1910, émerge comme un mouvement à part entière. Précédant le langage International, il est initialement désigné comme l’art moderne ou Nouveau style1. Le terme « Art déco » s’impose réellement dans les années 1960 dans les milieux universitaires et commence à être utilisé par la suite.
Style architectural transitoire entre le traditionalisme et la modernité, l’Art déco se caractérise par la verticalité, synonyme de progrès et d’optimisme. Pour ce faire, les édifices sont agrémentés de pilastres disposés en alternance avec des fenêtres verticales. Les pilastres et les entrées sont couronnés d’une ornementation stylisée suggérant une élévation vers le haut. Plus le bâtiment est élevé, plus il s’amincit en hauteur (retrait, décroché, palier, gradin, etc.).
Abandonnant tout rappel historiciste, l’Art déco se concentre sur les lignes droites. Les matériaux de l’enveloppe (comme le marbre, le granit) sont lisses et de couleur pâle. Évocateur de la modernité, le métal, comme l’acier ou le bronze, est régulièrement utilisé pour les ornements.
Plus dépouillée, l’ornementation est concentrée à certains endroits facilement visibles (couronnement, près des fenêtres et des portes, au centre de la façade). Celle-ci révèle souvent la fonction de l’édifice, l’industrialisation ou encore des motifs géométriques ou figuratifs stylisés, simplifiés ou schématisés.
Certains de ces motifs modernes puisent leurs inspirations dans l’art de l’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient et de la Mésoamérique, ainsi que des découvertes archéologiques antiques ou précolombiennes (égyptien, maya, aztèque, sumérien, etc.)
Quelques œuvres phares : Le Théâtre des Champs-Élysées à Paris, France (1913), les théâtres Empress (1927), Outremont (1928) et Le Château (1931), l’Édifice Aldred et la Maison Ernest-Cormier (1931), Montreal-Pharmacie (1934) l’édifice Holt Renfrew (1937) à Montréal, Canada, l’Empire State Building et le Chrysler Building à New York (É-U.) (1931), Mayan Theater à Los Angeles (E.-U.) (1927)
Et le Streamline moderne (ou Paquebot) ?
Courant de l’Art déco émergeant en force à la fin des années 1930, le Streamline Moderne réfère aux États-Unis au « cours du ruisseau » ou la « rationalisation moderne », tandis qu’en France, son équivalent s’exprime sous le terme de style « Paquebot ».
S’inspirant des véhicules motorisés et de la vitesse, il cherche à accentuer les lignes horizontales avec aérodynamisme. Les lignes droites se terminent par des angles arrondis, en courbe ou en demi-cercle, rappelant la forme d’un bateau. Les métaux sont apparents dans l’ornementation qui reste sobre.

Quelques œuvres phares : La Casa d’Italia, les théâtres Beaubien et Snowdon de Montréal (Canada) (1936), les paquebots Île-de-France (1927) et SS Normandie (1932) (France), le Musée maritime de San Francisco (É.-U.) (1939)
L’Art déco à toutes les sauces
Évoquant le luxe des années 1920, l’Art déco est adopté très rapidement par les grands magasins parisiens, comme La Samaritaine ou Le Printemps, en vue de commercialiser un style de vie moderne. Les architectes, artistes, décorateurs et ensembliers se l’approprient et l’adaptent à une multitude de contextes.
Visible en architecture et dans les arts décoratifs et visuels, ce mouvement à la fois totalisant et éclectique façonne autant les objets du quotidien, les tissus et les meubles que les bâtiments, les transports ou les jardins. Il inspire même le design de bateaux, trains, automobiles, et même d’appareils ménagers.
De l’Europe au Maroc en passant par les Amériques et en allant même jusqu’aux Indes, l’Art déco s’adapte facilement aux couleurs locales qu’il reflète par une esthétique emblématique de ce lieu.
Ce langage s’épanouit dans les décennies 1920 et 1930. Plus exubérant durant les Années folles, il s’assagit dans la décennie de la Crise économique.
Et à Montréal ?
« [….] les architectes montréalais ont développé un Art déco distinctif, avec un style et un vocabulaire uniques. Tempéré par la nature prudente des Canadiens et les longs hivers canadiens, ce style nordique de l’Art déco reflète les réalités culturelles, politiques, économiques et technologiques montréalaises. 2»
Sandra Cohen Rose
Comme ailleurs dans le monde, l’Art déco montréalais ne respecte pas exactement tous les critères théoriques du style architectural, mais ils sont suffisamment apparents pour observer la parenté.
L’Art déco est particulièrement populaire dans la métropole québécoise durant la décennie 1930. Le peu d’ornementation et les lignes simples permettent d’économiser sur les coûts de construction. Il devient ainsi le langage privilégié des édifices civiques construits durant les travaux de chômage, mais aussi des édifices scolaires de la région métropolitaine. Ces bâtiments publics incarnent la modernité, le progrès et l’optimisme qui triompheront de ces années de difficultés économiques.
À Montréal, l’utilisation des matériaux comme le granit ou le marbre est plus rare. Ce sont surtout des briques de couleur pâle (la brique chamois, par exemple) ou la pierre calcaire qui sont utilisées. Cela dit, les architectes n’hésitent pas à doter leurs édifices aux lignes épurées de matériaux des dernières technologies, tels que le béton armé, l’acier et le verre.
D’autre part, les symboles typiquement canadiens tels que le castor, l’écureuil, la feuille d’érable, l’épinette, le pin, le bouleau et bien d’autres sont habilement mariés à des éléments plus traditionnels de l’Art déco comme l’urne, le soleil levant et la cascade.
Quelques œuvres phares des édifices civiques des années 1930 : L’Auditorium et le Natatorium de Verdun, le pavillon d’accueil du Jardin botanique, les marchés Atwater, Saint-Jacques, Saint-Jean-Baptiste (démoli) et Jean-Talon, les bains Hogan, Quintal, Schubert, les casernes de pompiers n° 23 Saint-Henri, n° 31 Saint-Dominique, n° 48 Hochelaga.
Photo de couverture : Édifice Aldred, Place d'Armes, Montréal, La nuit, [entre 1930-1950]. Crédit : BAnQ
- D’autres termes sont aussi utilisés tels que : Modernisme, Jazz Style ZigZag et Style 1925. Sources : Sandra Cohen-Rose, Northern Deco : Art Deco Architecture in Montreal, Montreal: Corona Publishers, 1996.p.12 ↩︎
- Traduction de l’autrice. Source : Sandra Cohen-Rose, Northern Deco : Art Deco Architecture in Montreal, Montreal: Corona Publishers, 1996. p.11 ↩︎




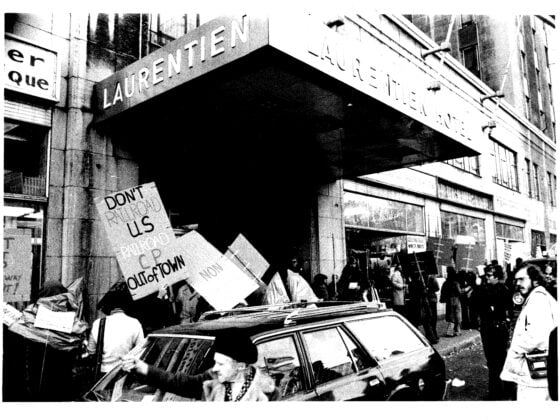


1 commentaire
Bravo et surtout out grand merci pour cet article. Merci