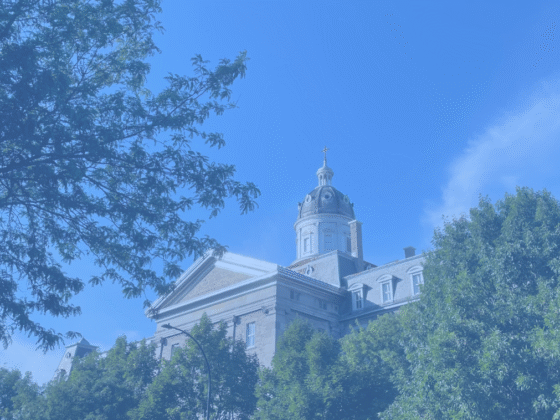Cet article a été initialement rédigé en anglais. Cliquez ici pour accéder à la version originale.
Voici une anecdote amusante. En 2007, j’ai organisé un événement intitulé Logo Cities: An International Symposium on Signage, Branding, and Lettering in Public Space (Logo Cities : un symposium international sur la signalisation, l’image de marque et le lettrage dans l’espace public), à l’Université Concordia.
Logo Cities a réuni plus de trente intervenants issus d’un éventail éclectique de disciplines et de professions. Au programme on trouvait notamment un conférencier de marque, une galerie d’anciennes enseignes et de nouvelles œuvres d’art, et la première québécoise d’un splendide film documentaire intitulé simplement Helvetica (États-Unis, 2007, réalisé par Gary Hustwit). Oui, il s’agissait bien d’un film sur une police de caractères.
Le principe clef de cet événement à succès fut la notion d’hyper-commercialisme. Il s’agit d’une reconnaissance marquée du fait que, dans les économies capitalistes les plus développées du début du 21e siècle, le nombre d’enseignes publicitaires et de messages de marketing s’est intensifié de façon exponentielle. Ces tendances fortes se sont bien installées dans tous les recoins médiatiques et culturels. Pour moi, cela s’incarnait explicitement dans la ligne d’horizon montréalaise marquée par une constellation d’énormes logos visibles au sommet de la plupart des gratte-ciel du centre urbain. Quelle meilleure représentation des investissements économiques et culturels d’une ville à un moment précis de son histoire que ces enseignes lumineuses ?
Et le plus ironique dans tout ça ? Tout en restant attachée à l’idée d’un hyper-commercialisme assumé, l’exposition Logo Cities a amené mes collègues et moi à réaliser que certaines des enseignes locales les plus modestes possèdent une véritable valeur sociale pour les personnes qui ont vécu, travaillé ou magasiné à proximité. Ces enseignes revêtent une importance réelle du point de vue du patrimoine urbain. Qui plus est, après le colloque, nous avons constaté que les trois enseignes tout juste retirées de la circulation et transportées à la galerie pour l’exposition risquaient de disparaître à jamais.
Que représente donc la présence de cette enseigne en ville ? Un excès hyper-commercial ou un patrimoine culturel inestimable ? Réponse courte : les deux.
Trois ans après Logo Cities, et malgré bien des réactions sceptiques, j’ai obtenu l’autorisation de l’Université Concordia d’exposer en permanence les cinq premiers panneaux du Projet d’enseignes de Montréal dans le Pavillon des études en communication et en journalisme, sur le campus Loyola.
J’en profite pour exprimer ma profonde gratitude à ma complice Nancy Marrelli, ainsi qu’à deux autres collègues de Concordia — Graham Carr et feu Justin Powlowski — qui ne m’ont jamais dit « non ». Et à tous les directeurs de département, collègues visiteurs, membres du personnel, étudiant·e·s et ancien·ne·s qui m’ont accordé leur indulgence depuis, je dis merci.

À la fin novembre 2024, la collection comptait plus d’une cinquantaine d’enseignes, avec de nouvelles pièces qui s’ajoutent en moyenne tous les deux mois. Pour ne nommer que quelques exemples, on y trouve des enseignes lumineuses en plexiglas, des lettres tridimensionnelles finement façonnées en métal ou en bois, des lettres en métal à canaux ouverts ou fermés avec tubes au néon, des requins animés par fibres optiques dissimulées, des panneaux sérigraphiés ou thermoformés, des plaques de métal peintes à la main sur cadre de bois, des enseignes en verre peint datant des années 1930, ou encore des boîtiers métalliques confectionnés avec minutie. Et que dire des deux grands panneaux d’information passagers provenant de l’ancien terminal de l’aéroport de Mirabel.
Aujourd’hui, vingt-cinq panneaux du Montréal Signs Project sont exposés en permanence sur le campus Loyola (Pavillon CJ). Quatorze autres ont été prêtés de façon permanente au MEM – Centre des mémoires montréalaises (anciennement le Centre d’histoire de Montréal), qui a ouvert ses portes en 2023 !

Au sein du MEM est notamment exposée la majestueuse enseigne de l’Église unie St James, qui a été conçue, fabriquée et installée par le célèbre fabricant d’enseignes Claude Néon en 1947. Ce glorieux mastodonte de vingt pieds de hau tà double face fut sauvé par le révérend Arlen Bonnar. L’enseigne impressionne avec ses néons bleus et rouges.
Plusieurs autres enseignes sont en cours de réparation ou sont entreposées temporairement, dont le bandeau de Dépanneur Lalonde à St Henri et un énorme train à vapeur en néon provenant de l’ancienne entreprise Udisco qui était située sur le boulevard Décarie.
Depuis 2010, nous avons beaucoup appris. Certes, ces enseignes ne représentent plus nécessairement les commerces d’aujourd’hui, mais elles demeurent des témoins précieux de l’évolution de la vie urbaine et commerciale de Montréal à travers le temps. Elles incarnent des souvenirs et des repères du quotidien dans chaque quartier. Elles racontent aussi l’histoire des commerçant·e·s qui les ont commandées et qui ont gagné leur vie dans le commerce de détail. Elles évoquent également des enjeux plus vastes liés à la migration et à l’entrepreneuriat. Ces enseignes ont le potentiel de révéler les histoires méconnues de leurs fabricants ainsi que l’évolution des technologies dans ce domaine. À la lumière de ces réflexions, il ne fait aucun doute que même les enseignes les plus modestes sont de véritables réservoirs de mémoire « ordinaire ». Les débats entourant le retrait (et la réinstallation rapide) de l’enseigne du magasin de musique Archambault, ou encore la décision unilatérale d’Archer Daniels Midland, en 2006, de désactiver l’enseigne Farine Five Roses (rénovée et réinstallée depuis), en sont des illustrations frappantes.
Au Projet d’enseignes de Montréal, nous avons appris à privilégier les marques locales plutôt que les enseignes génériques ou internationales : Warshaw et Steinberg, plutôt que Loblaw ou Costco ; le Café Navarino et le Dépanneur Lalonde, plutôt que Starbucks ou Dollarama. Nous ne cherchons pas à rivaliser avec celles et ceux qui collectionnent les anciennes marques commerciales. Si quelqu’un veut les conserver dans une salle d’arcade ou sur le mur de son café, tant mieux ! (Par contre, si elles prennent la direction de la benne, il faut qu’on en parle !). Nous misons sur la sérendipité : parfois, il suffit qu’un donateur potentiel tombe sur nous via les réseaux sociaux. Cela dit, certaines enseignes semblent résister au sauvetage : pensons à la taverne Magnan ou au Jardin Tiki.
Nous ne faisons rien d’aussi grandiose que la « restauration » [merci Nancy !] : nous réparons avec bienveillance, si nécessaire. Le MSP est, après tout, une maison de retraite pour vieilles enseignes, et non un musée ; un zoo d’enseignes, et non une galerie d’art ; un amas adorable de détritus commerciaux, et non les joyaux de la couronne. Avec ce projet, nous visons à défendre cette forme de patrimoine montréalais, celle de ses enseignes historiques, grâce à la sensibilisation. Nous souhaitons alimenter cette conversation empreinte d’un sens de la nostalgie non dissimulée. À cet égard, nous félicitons les arrondissements de Ville-Marie et du Plateau-Mont-Royal d’avoir établi des registres locaux d’enseignes à sauvegarder.
D’une certaine manière, le Projet d’enseignes de Montréal a cinquante ans de retard, comme en témoigne n’importe quelle photo d’époque de la rue St-Hubert ou de la rue Ste-Catherine. À mon avis, ce qui était autrefois une fête visuelle, une cacophonie de chapiteaux au néon, d’enseignes grimpant pratiquement les unes sur les autres pour être vues, une myriade de lettrages divers, de logos et d’animations, a disparu pour être remplacé par des enseignes sobres qui nous donnent l’impression d’être dans n’importe quelle ville d’Amérique du Nord. Ce qui m’amène à une autre forme de préoccupation liée aux enseignes : on retrouve aujourd’hui des caissons lumineux en abondance, conçus de manière pitoyable, avec des mises en page vraiment minables, des lettres en vinyle qui s’écaillent, des caractères étirés et déformés, et des images clip art obscures. Et pourtant, des musées et des expositions sur les enseignes continuent de voir le jour : le Vancouver Neon Project, le Neon Sign Museum (Edmonton), l’American Sign Museum (Cincinnati), le Neon Museum (Las Vegas), l’Ignite Sign Art Museum (Tucson) et le San Francisco Neon. Souvent, nous recevons un indice révélant l’existence d’une nouvelle enseigne cachée ou rangée dans le garage de quelqu’un depuis vingt, quarante ou soixante ans dont je n’ai jamais entendu parler. Il suffit alors d’activer l’esprit de ruche des médias sociaux montréalais pour que les anecdotes enthousiastes, les souvenirs vivaces et les photos d’archives commencent à faire surface. C’est alors que l’on sait que l’on a trouvé l’enseigne d’or.
________________
Le Projet d’enseignes de Montréal est ouvert au public et son directeur, Matt Soar, est ravi d'organiser des visites pour de petits groupes sur demande. Il vous est également reconnaissant de bien vouloir aider dans le financement de leurs activités en faisant un don ici sur montrealsignsproject.ca.